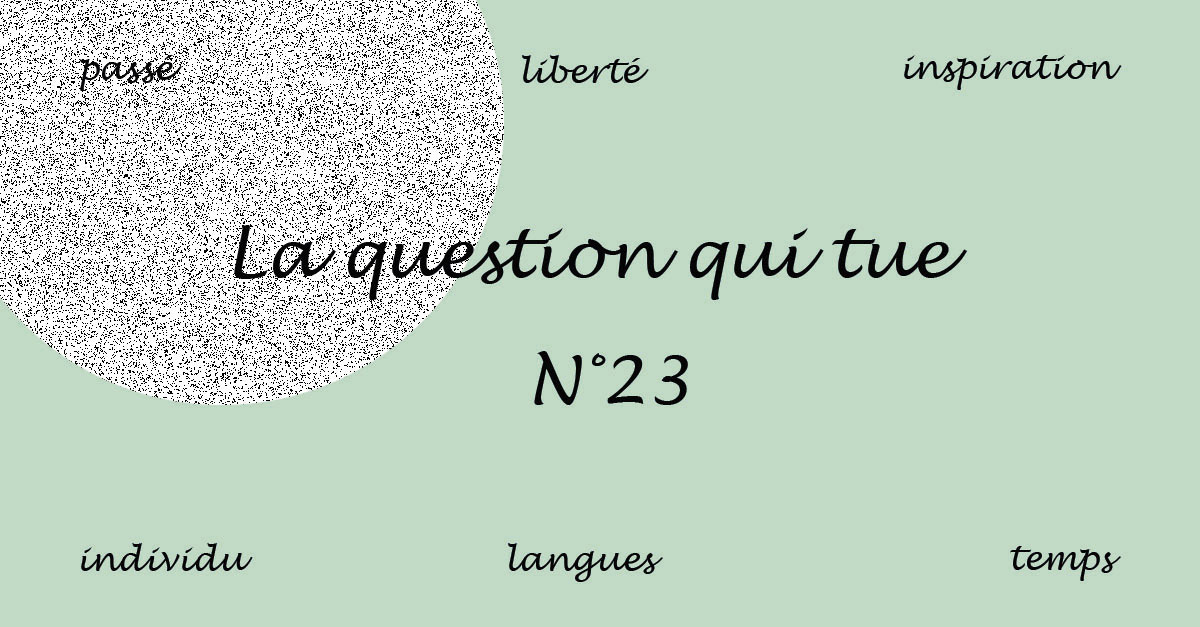Comme tu l’écris dans la question qui tue No 21> le lecteur devient consommateur. Je le constate autant sur internet que dans les classes que j’ai rencontrées dernièrement avec mon nouveau livre> L’une des premières questions que l’on me pose systématiquement est «combien gagnez-vous?» ou «combien de livres avez-vous vendu?» Combien, combien, combien ? Cela me fait d’autant plus mal au cœur quand ce sont des enfants, pas même encore des ados, qui me le demandent. J’essaie de répondre de mon mieux. Heureusement, il y a aussi de belles rencontres, des élèves qui parlent de leur livre préféré avec des étoiles dans les yeux…
Remarques-tu la même chose?
[question adressée par Mélissa Pollien, jeune auteure]
Chère Mélissa,
Merci pour ta question et tes remarques qui témoignent d’une tendance aussi réelle que crue. Elle ne m’a pas échappé. Si tel était le cas, tu pourrais légitimement penser que je vis dans une grotte. Ou que j’ai quatre-vingt-dix ans, et qu’ayant malgré tout continué à écrire, on ne m’adresse plus que des questions ayant trait aux métaphores, aux sous-textes des textes et à la vie poétique en général. Car c’est ce qui arrive aux littérateurs devenus assez vieux pour qu’on les considère enfin comme de grantécrivains, même s’ils ont peu vendu.
Dans nos sociétés développées et supposément éduquées, le combien s’est imposé depuis pas mal de temps comme un très fiable critère de jugement. Non seulement de la quantité – ce qu’il est bel et bien – mais aussi de la qualité. Au point que ces deux notions se confondent, en particulier dans l’art.
En témoignent ces chiffres qui, à eux seuls, permettent de tout dire du succès et du talent: prix des objets et installations vendus par les artistes contemporains les plus en vogue, nombre de personnes venues assister à un concert, une rencontre ou à n’importe quel spectacle, nombre d’exemplaires vendus de ceci et de cela, et bien entendu aussi de livres. Certains bandeaux sont d’une sobriété si exemplaire qu’ils n’ont plus besoin de parler du texte, mais peuvent se contenter d’annoncer déjà 3 millions d’exemplaires vendus... Le corollaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause, est constitué par ces innombrables hit-parades, construits sur l’unique critère du combien. Ils sont devenus – quelle surprise! – identiques dans toute l’Europe, à peu de choses près, quelle que soit la langue.
L’inévitable question, que je ne vais pas me gêner de poser à cet endroit précis, est la suivante: pourquoi ne propose-t-on pas des hit-parades qui mettraient en évidence les livres les plus intéressants – indépendamment de leurs chiffres de vente – sortis ce mois-ci en littérature et autres catégories, et aussi les disques, les films, pièces de théâtre, expositions etc? Hit-parades qui seraient assumés par leurs concepteurs, au point que ceux-ci s’en expliqueraient dans des articles critiques développés. Dans le mouvement, on s’apercevrait bientôt de l’inutilité de tels classements, si bien que l’espace qui leur est dévolu pourrait être occupé par des articles supplémentaires.
Qu’est-ce qui empêche de le faire?
La flemmardise? L’immense flemmardise conjuguée à la force de conviction du marché qui, ne maniant que le très pur langage des chiffres, permet d’éviter ces horreurs que sont la subjectivité, la capacité à juger et à étayer son jugement?
Peut-être bien.
En attendant, je me demande ce qui interdit de dresser des classements montrant qu’en matière culinaire, McDonald's et autres chicken de chez Kentucky-Starbucks-Subway-etcétéra sont vraiment les plus vendeurs, par conséquent les meilleurs. Du coup, il n’y aurait plus besoin de parler du travail de tel et telle chef-fe à toque, sous prétexte qu’ils visent à la pureté et à l’exception dans leur art. On connaîtrait aussi enfin les terrasses de chez MacDo qui nous sont les plus recommandées, ici et dans l’ensemble de l’Europe.
J’en suis presque venue, dans ma douce naïveté feinte, à m’ébahir lorsqu’on me pose des questions qui ont trait à autre chose qu’aux chiffres, au succès, à la notoriété et qualités du même genre. Surtout dans les occasions où je me suis retrouvée devant un jeune public, qui est allé jusqu’à prendre la peine de me dire haut et fort qu’il ne lisait pas. Dans les cas où il a évité de le reconnaître, sans doute par politesse, je l’avais deviné.
En me basant sur ma propre expérience, déjà assez longue, mais par la force des choses limitée, je dirais que les questions liées au combien sont systématiques et très directes chez les publics jeunes, et presque toujours sous-entendues au sein des assistances plus «mûres». Alors j’y réponds, et en profite pour élargir aussitôt l’angle de vision.
Les questions des jeunes sont d’ordinaire préparées en classe, sous la supervision d’un ou d’une professeur… Au final, ces «questionnaires» sont souvent lamentables. De quoi s’interroger, pas vrai? Et se demander qui formate qui, au bout du compte.
Je n’ai pas de réponse à cette question, seulement un soupçon.
Quel que soit le public, j’en viens donc très vite à parler de littérature, et même d’écriture, de choix, de liberté, d’individualité, et à inciter les auditeurs à poser des questions spontanées. Il en résulte le pire comme le meilleur, la fréquence du pire étant, auprès des jeunes, et même si je suis malheureuse d’avoir à le constater, beaucoup plus élevée. Non, vraiment, ils ont beau se creuser la tête, ils ne trouvent pas d’autres sujets. Ceci n’empêche pas les miracles de survenir. Et c’est peu dire qu’ils se gravent dans la tête au moins aussi bien que les rencontres de bas étage. Quant à savoir à quoi tiennent les miracles, je me risque à le dire: à l’ouverture d’esprit de chaque personne, à sa capacité à s’intéresser aux choses en dehors de toute obligation, à son degré de curiosité envers ce qui lui échappe et pourtant la constitue. Bref, toutes sortes d'aptitudes censées être développées par l’éducation, l’école, et carrément par la vie…
Le fait est qu’il suffit d’un livre pour se retrouver, en tant qu’auteur, en terrain miné. Notre responsabilité, chère Mélissa, est de procéder au déminage à nos risques et périls, d’autant que personne ne va le faire à notre place. Alors oui, il faut puiser dans ses forces. Ne pas avoir froid aux yeux. Garder confiance, parce que dans le tas, quelques étoiles finiront bien par s’allumer.
Les chiffres sont utiles, indispensables. Ils parlent, eux aussi. Mais ils disent rarement l’essentiel. Il ne tient donc qu’à nous, à chaque fois que l’occasion se présente, de les remettre à la place qui est la leur.
Une suggestion de lecture:
Requiem, et autres poèmes de Anna Akhmatova >
Voici des mots dont aucun lecteur, et surtout pas le lecteur russe, ne s’est jamais demandé s’ils se sont bien vendus. Ils s’y sont plutôt accrochés, afin de respirer et de pleurer, quand tout était devenu irrespirable et les larmes interdites. Ce sont des mots-miroirs, choisis avec précaution par cette poétesse russe à la vie tourmentée, pour dire des douleurs quasi indicibles, et passer malgré tout la censure d’un régime meurtrier, devenu complètement fou. Parler au nom de tous, être capable de mettre des mots sur ce qui rend muets la plupart des gens, qu’il s’agisse de la beauté délicate ou de l’oppression ordinaire et extraordinaire, voilà à quoi sert aussi l’écriture. À consoler tout en ravivant des plaies, à dire l’existence dans toute sa beauté et son absurdité, allez y comprendre quelque chose…
«J’ai beaucoup à faire aujourd’hui;
Il faut tuer toute la mémoire.
Il faut que l’âme devienne pierre,
Il faut apprendre à vivre encore.»
© catherine lovey, le 10 février 2017
C'était...